La croissance économique Jean Magnan de Bornier Table des matières 1 La révolut
La croissance économique Jean Magnan de Bornier Table des matières 1 La révolution industrielle 4 1.1 Éléments moraux et religieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Éléments institutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 Les innovations techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 Éléments économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Les déterminants du taux de croissance 7 2.1 La fonction de production macroéconomique . . . . . . . . . . . 7 2.2 La croissance du produit national . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Le rôle des différents facteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4 L’évolution irrégulière de la productivité globale . . . . . . . . . . 10 2.5 L’hypothèse de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6 Croissance éxogène ou croissance endogène . . . . . . . . . . . . 12 Introduction La croissance économique peut être définie comme l’évolution à moyen et long terme du produit total et surtout du produit par tête dans une économie donnée. C’est un concept étroit et exclusivement quantitatif, auquel on préfère parfois le concept beaucoup plus étendu de développement qui prend en compte les aspects qualitatifs (humains, culturels, environnementaux,etc.) que l’approche quantita- tive néglige par nature. La croissance économique n’est pas un fait naturel ; c’est au contraire un évè- nement historique exceptionnel, dont le début est récent : le dix-huitème siècle pour la Grande-Bretagne ; le dix-neuvième pour quelques autres pays occiden- taux : la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie ; le vingtième siècle pous beaucoup d’autres, mais pas tous. 1 LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 2 L’analyse de ce phénomène implique deux grands types de problèmes : celui du déclenchement de la croissance d’une part, et celui du rythme ultérieur de la croissance d’autre part. Le déclenchement de la croissance correspond à un ensemble de modifications structurelles de l’économie qui permettent de passer d’une économie es- sentiellement statique se reproduisant quasiment à l’identique d’année en année, et centrée sur la production agricole, à une économie progressive dont l’industrie se développe et attire une proportion de plus en plus large des ressources productives. C’est la phase de la révolution industrielle ou "décollage" (take-off). Cette phase s’étend sur plusieurs décennies. Pour la Grande-Bretagne, elle se situe, selon les auteurs, de 1770 à 1870 (Abbott P. Usher) ou de 1760 à 1830 (T. S. Ashton). En France on peut la situer entre la Restauration (1814) et la Révolution de 1848 (ou la guerre de 1870). Le rythme de la croissance, après ce premier épisode, correspond au taux de croissance de la production et du revenu sur une période plus ou moins longue ; il s’agit d’expliquer le taux de croissance moyen en laissant de côté les variations conjoncturelles qui au regard du long terme ne sont que des accidents. Pourquoi à certaines périodes ce taux a-t-il été très élevé (entre 3 et 5% annuels pendant les "trente glorieuses" de 1945 à 1975), alors qu’à d’autres périodes il reste aux alentours de 1,5 à 2% ? l’analyse ici doit néces- sairement être statistique et reposer sur des chiffres et des modèles précis. Ces deux aspects, qualitatif ou structurel, et quantitatif, font l’objet de trai- tements très différents ; mais tous deux ressortent de la théorie de la croissance économique, et de nombreux mécanismes peuvent avoir une valeur explicative dans ces deux champs. On les présentera successivement après avoir évoqué quelques éléments chif- frés. Le tableau 1 indique les étapes de la croissance économique de quelques pays occidentaux depuis la première révolution industrielle1. Les disparités dans la vitesse de l’évolution sont frappantes. Mais si on prend un échantillon de pays plus large, les disparités apparaissent encore plus fortes ; certains pays ou régions du monde n’ont pas, au début du XXIème siècle, connu de révolution industrielle, et connaissent des taux de crois- sance très faibles et même parfois négatifs. Le graphique 1 permet la comparaison du produit par tête en France et au Bangladesh. 1Source : Bairoch et Lévy-Leboyer : Disparities in Economic Development LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 3 FIG. 1 – Produit par habitant : France et Bangladesh, 1950-90 LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 4 1830 1860 1913 1929 1950 1960 1970 Allemagne (RFA) 240 345 775 900 995 1790 2705 Canada 280 405 1110 1220 1785 2205 3005 Espagne - 325 400 520 430 604 1400 États-Unis 240 550 1350 1775 2415 2800 3605 France 275 380 670 890 1055 1500 2535 Japon 180 175 310 425 405 855 2130 Portugal 250 290 335 380 440 550 985 Grande-Bretagne 370 600 1070 1160 1400 1780 2225 TAB. 1 – Estimation du revenu par tête en dollars US de 1960 1 La révolution industrielle Un ensemble d’évolutions structurelles, dont certaines se sont produites sur une durée de plusieurs siècles, permettent de rendre compte de la révolution indus- trielle. Certaines d’entre elles ont un rôle causal ou déclencheur alors que d’autres constituent simplement un environnement favorable. Vu le grand nombre de ces mutations, il est peut-être futile de chercher à iden- tifier une cause unique de la révolution industrielle. On regroupe ici ces différents éléments dans les rubriques suivantes : éléments moraux, institutionnels, techniques, économiques. 1.1 Éléments moraux et religieux L’évolution des éléments religieux et moraux ayant contribué à la révolution industrielle, évolution dont le début peut être situé grossièrement à la Renais- sance, est liée à la Réforme, avec une emprise affaiblie du catholicisme dans les mentalités. Le protestantisme, comme l’a montré Max Weber, est moins enclin à condamner certaines activités comme le prêt d’argent contre intérêt. Au XVIe siècle les scolastiques de l’école de Salamanque2 ont eux-mêmes admis que cer- taines circonstances justifient le paiement d’un intérêt. Des écrits mettent en évidence les bienfaits de la recherche du profit, comme par exemple le très influent ouvrage de Bernard Mandeville (médecin hollandais), publié pour la première fois en 1714, intitulé "La Fable des Abeilles", dont le sous-titre significatif est "Vices privés, bénéfices publics". D’autre part, d’un point de vue sociologique, la recherche du gain devient une activité avouable, même s’il n’est pas prôné par les autorités morales ; les expé- ditions maritimes et les exploitations des colonies (Amérique, Asie) sont dirigées 2Qui appartiennent bien sûr à l’église catholique LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 5 par des hommes aventureux et attirés par la fortune rapide. 1.2 Éléments institutionnels Les institutions ont évidemment joué un rôle important dans la révolution in- dustrielle. La Grande-Bretagne est un des pays dans lesquels le statut de l’indi- vidu a été le plus rapidement dégagé des carcans de la société féodale. L’école des droits de propriété, menée par Douglass North, considère que c’est le développe- ment de la propriété qui est le facteur principal de la révolution industrielle. Le droit de propriété qui apparaît comme un droit abstrait et universel est accessible à tous, et la société anglaise perçoit l’inefficacité de la propriété col- lective, relativement à la propriété individuelle : dans l’épisode des "enclosures", les pâtures collectives ou commons, où chaque éleveur pouvait amener ses bêtes, sont reconnues comme une forme insatisfaisante de propriété parce qu’aucun des usagers n’est incité à entretenir correctement les lieux qu’il utilise, sachant que ce serait son successeur qui profiterait de ses efforts. De plus en plus les com- mons qui restaient en friche sont clôturés et transformés en propriétés privées au cours du XVIIIème siècle. Les enclosures permettent la constitution de grandes exploitations où l’agriculture scientifique peut être pratiquée. Une autre innovation dans la pratique de la propriété est importante : l’inven- tion ou plutôt la mise en place progressive du brevet (patent) et plus générale- ment de la propriété intellectuelle. Grâce à elle, les inventeurs savent que leurs découvertes sont protégées et qu’ils en tireront une rémunération. Ils sont incités à développer les idées qu’ils conçoivent. 1.3 Les innovations techniques Le progrès technique est une condition nécessaire de la révolution industrielle, qui sans lui aurait été une lente évolution. Les innovations majeures vont dans deux directions : La substitution de la force humaine ou animale par celle des machines, et le remplacement des matières premières animales ou végétales par des matières premières fossiles, essentiellement le charbon. Les machines à vapeur constituent une première direction de l’innovation : à la toute fin du XVIIième siècle un premier instrument à vapeur est utilisé pour ac- tionner une pompe (brevet de Savary en uploads/Industriel/ croissance-economique 1 .pdf
Documents similaires




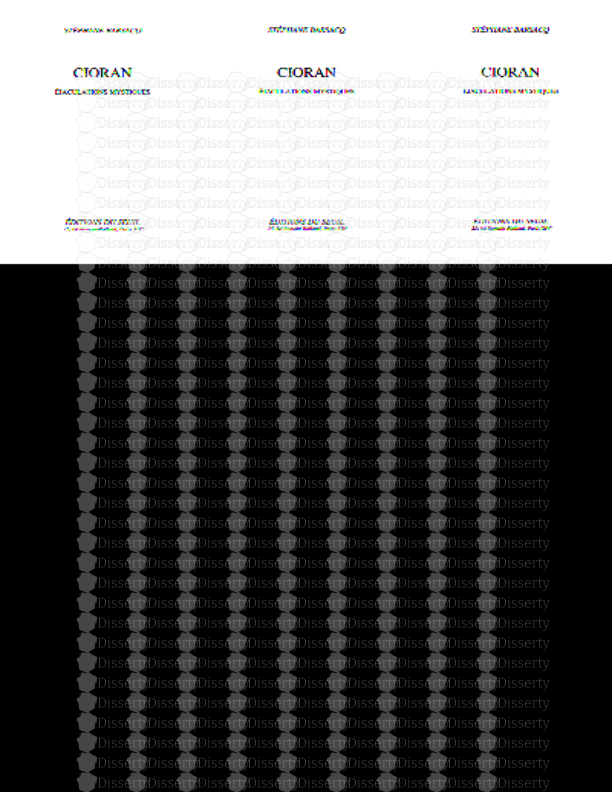





-
105
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 25, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0910MB


