LA LIBERTE « Liberté : c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur
LA LIBERTE « Liberté : c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens; qui chantent plus qu'ils ne parlent; qui demandent plus qu'ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence ; aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. » Paul Valéry Assurément, la liberté est l’une des notions du programme les plus polysémiques et équivoques ; ses concepts et champs d’usage sont nombreux. En même temps, elle constitue ce que Leibniz appelle un labyrinthe, c’est-à-dire l’une des questions cardinales de la philosophie première (métaphysique) que la raison ne saurait résoudre définitivement ; Kant reprendra cette idée dans la Dialectique transcendantale (Critique de la raison pure) en en faisant une antinomie de la raison pure (deux thèses sont également légitimes : il y a une liberté au sens d’une capacité pour un sujet de commencer une série causale – tout est soumis à l’universelle nécessité). « L’homme est né libre, et partout, il est dans les fers » (Rousseau, Second discours). Bien sûr, la première chose qui vient à l’esprit, c’est la liberté politique, la plus facile à ressentir (surtout lorsqu’elle fait défaut). Mais, en vérité, la langue emploie volontiers la vérité également à propos de choses : le libre cours du fleuve ou la chute libre d’un corps, nous rappellent que la liberté, c’est d’abord l’absence d’empêchement, d’obstacle. A ce titre, l’animal sauvage serait libre, a contrario de son frère domestiqué. La nature et la liberté, ici, se confondent. Et pourtant, elles s’opposent tout autant, car l’animal ne peut contrarier son instinct, tandis que l’homme en a le pouvoir. C’est ainsi qu’on en vient à l’idée d’une liberté morale, ou libre arbitre, c’est-à-dire à l’hypothèse d’une liberté propre à la volonté, à l’âme ou au sujet en tant qu’auteur de ses actions. Telle est la généalogie de la liberté en tant que libre arbitre, telle que l’établit Schopenhauer dans le Traité du libre arbitre. La raison pour laquelle, donc, la problématique du libre arbitre, c’est-à-dire celle qui fait ressortir une alternative entre l’existence d’une causalité par volonté libre et l’universalité d’une causalité nécessaire, est la question cardinale est que les questions morales, et, a fortiori, politiques, lui sont subordonnées. Pour le dire à la manière de Kant, « le libre arbitre est un postulat de la raison pratique » quoique un problème pour la raison théorique. Je pourrai, sur un plan théorique, faire prévaloir, à l’instar de Démocrite, Spinoza, Schopenhauer, Laplace et tant d’autres, la nécessité sur la liberté de l’arbitre ; dans la vie pratique, je demeurerai contraint d’attribuer des actes à des sujets (ce qui revient à poser qu’ils auraient pu ne pas les commettre, ou en commettre d’autres), car le libre arbitre s’impose comme condition d’imputabilité d’une action à un sujet. Lorsque un prévenu est relaxé car dément, c’est précisément parce que cette condition fait défaut – encore cela ne peut-il être que le fait d’une exception. Ce n’est pas que la vie sociale qui est tributaire de la liberté, c’est ma propre vie. Bien sûr, mes choix peuvent être restreints, et la liberté d’Edmond Dantès au Château d’If se restreint à celle d’accepter sa nourriture ou de la refuser. Mais n’est-ce pas qu’être libre – moralement – consiste moins à pouvoir faire ce qu’on veut qu’à pouvoir choisir en toute liberté parmi les options qui se présentent ? Celui dont la volonté est aliénée (qui par un vice, qui par une drogue, qui par la démence) n’est-il, quelle que soit son pouvoir, le moins libre ? Il nous revient donc en premier de considérer le problème métaphysique du libre arbitre, tel qu’il prend sa forme canonique dans la philosophie moderne classique : cela impliquera de donner toute sa place, non seulement à l’affirmation de cette hypothèse, mais aussi à ses détracteurs (1). Cette controverse ou antinomie accouche en même temps que naît la physique classique, avec Laplace, du déterminisme, qui concentre bien des questions épistémologiques générales et spéciales (i.e. propres à une science particulière, par exemple : qu’en est-il du déterminisme en sociologie ? etc.) : c’est pourquoi la seconde partie de notre réflexion abordera ce déterminisme en demandant s’il faut l’assimiler ou l’opposer au fatalisme (2). Une éventuelle troisième partie aborderait la question des conditions d’une libération, tant individuelle que collective. (3) I/ Genèse et problème du libre arbitre a) Genèse de la notion Les Grecs ont développé le concept de liberté - "Eleutheria"- en référence à la déesse éponyme. Dans la pratique, la notion avait une signification sociale et politique: être libre signifiait le contraire d'être esclave; était libre le citoyen, mais surtout le citoyen délivré par son statut de l'obligation de travailler. Mais on désignait d'abord comme libre une cité souveraine, c'est-à-dire indépendante. En fait, le concept de liberté morale, individuelle, comme attribut de la volonté, n'est pas conceptualisé de façon explicite; H. Arendt en fera même un produit de la pensée chrétienne archaïque, ce qui est peut-être exagéré. Aristote par exemple accorde une grande importance à la "délibération libre"; mais il est vrai que les Anciens ne conçoivent pas d'opposition primordiale entre le sujet et la nature (physis, cosmos): l'homme est partie prenante de l'ordre universel, il ne peut donc pas réellement s'y opposer. Seuls les stoïciens, dialectiquement, en poussant au pinacle l'universelle nécessité, conçoivent une liberté de la volonté, mais comme choix entre le consentement au destin - qui est sagesse - et déraison. Il s'agira, pour les stoïciens, au moment épochal de la mort d'Alexandre et de l'éclatement de l'Empire grec, qui préfigure de peu la colonisation par Rome, de poser la possibilité d'une liberté en esprit, là où la liberté dans la cité de la Grèce archaïque et classique paraît désormais hors de portée: la liberté des stoïciens est une pure liberté de l'assentiment, c'est-à-dire, eussent dit les philosophes grecs classiques, une liberté d'esclave. «Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et le cours de ta vie sera heureux.» (Epictète, Manuel, VIII) b) L'affirmation du libre arbitre Préfigurée dans le stoïcisme, mais en contre-point intenable de l'universelle nécessité, la liberté de l'arbitre est thématisée en 388 par Augustin d'Hippone dans son Traité du libre arbitre, avec pour motivation essentielle de préserver le Créateur de la responsabilité du mal, et donc comme corrélat du dogme paulinien* du péché.* Augustin n'envisage toutefois la liberté de l'arbitre qu'avec inquiétude, car ne pouvant être que le fait d'un don, elle ne remplit qu'imparfaitement sa fonction de blanchir Dieu de l'humaine turpitude*: « D’où vient que nous agissons mal ? Si je ne me trompe, l’argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Mais ce libre arbitre auquel nous devons notre faculté de pécher, nous en sommes convaincus, je me demande si celui qui nous a créés a bien fait de nous le donner. Il semble, en effet, que nous n’aurions pas été exposés à pécher si nous en avions été privés ; et il est à craindre que, de cette façon, Dieu aussi passe pour l’auteur de nos mauvaises actions (De libero arbitrio, I, 16, 35). » Ultérieurement, la liberté de la volonté humaine s'affirme donc comme un dogme théologique: on a toujours le choix, parmi les choix qui se présentent bien entendu. La chose se complexifie dans la mesure où en théologie vient interférer la problématique sotériologique* (relative au Salut n.b.): moins le salut dépend des œuvres(comme chez Calvin par exemple), plus le libre arbitre est vidé de substance. Bossuet déclare: "La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut mais de vouloir ce que l'on fait." Il ne faut pas se tromper: la liberté de Bossuet n'est pas la nôtre, comme liberté de dire "non", et la liberté n'est pas l'étendard de l'Ancien Régime, où chacun, du serf au plus éminent duc, n'est que sujet du roi très catholique. Néanmoins, pour être l'hagiographe de la monarchie absolue et l'idéologue de la Contre-réforme, l'évêque de Meaux n'en est pas moins théologien, et si l'usage à faire de sa liberté n'en est pas moins prescrit, l'affirmation de la liberté métaphysique de l'arbitre est radicale, comme elle l'est chez René Descartes. C'est sans doute que le double assaut de la Réforme et de la révolution scientifique, qui renouvelle le thème antique et démocritéen de l'universelle nécessité, rend cette digue non moins stratégique que la citadelle de la Rochelle. C'est néanmoins, à la même époque, s’appuyant également sur l’argument de l’évidence, que Descartes s’affirme comme le père de la liberté moderne, au sens métaphysique, car Descartes extrait de son origine théologique la liberté de l'arbitre: "La volonté est tellement libre, qu'elle ne peut jamais être contrainte." Autant dire - et Descartes le fait dans les Méditations métaphysiques (1641), que la uploads/Philosophie/ la-liberte-iii.pdf
Documents similaires



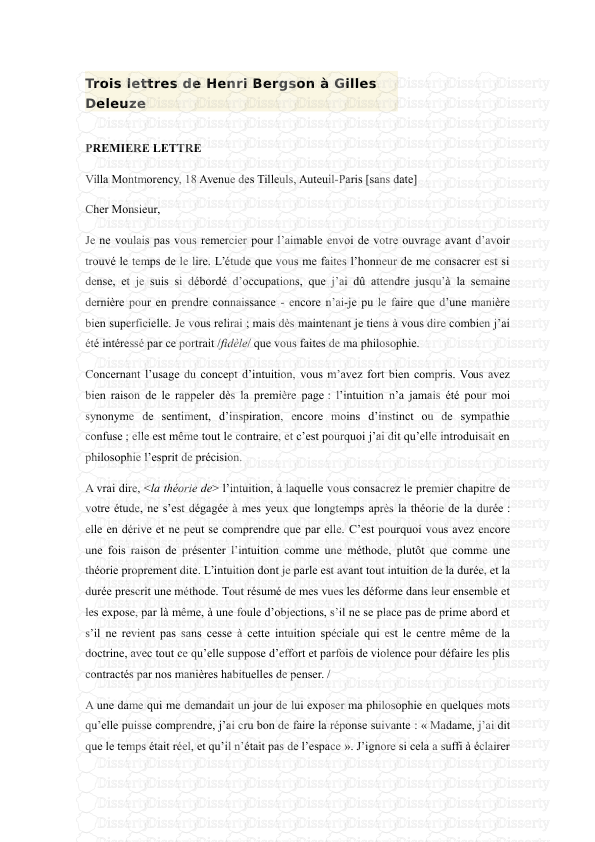






-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 06, 2023
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0919MB


