© Dunod, 2019 Dunod Éditeur 11, rue Paul Bert 92240 Malakoff http://www.dunod.c
© Dunod, 2019 Dunod Éditeur 11, rue Paul Bert 92240 Malakoff http://www.dunod.com ISBN : 978-2-10-079811-7 Sommaire Couverture Page de titre Page de copyright Introduction 1 La démocratie athénienne 2 La pensée moderne de la démocratie 3 Les doctrines du contrat social 4 De la liberté de participation à la liberté d’autonomie : Benjamin Constant (1867-1830), critique de Rousseau 5 La souveraineté 6 Le peuple 7 Les ambiguïtés de la liberté et de l’égalité 8 La démocratie et le monde contemporain Conclusion PARTIE 1 - Aristophane, Les Cavaliers, L’Assemblée des femmes CHAPITRE 1 - Le contexte de l’œuvre 1 La vie d’Aristophane (445-385 av. J.-C.) 2 La démocratie athénienne, résultat d’une longue évolution 3 Aristophane, un homme de paix face à la guerre du Péloponnèse 4 Les institutions de la démocratie d’Athènes 5 Les riches et les liturgies 6 Démocratie et oligarchie CHAPITRE 2 - Les Cavaliers 1 Résumé de la pièce 2 Arrière-plan politique des Cavaliers 3 Les principaux personnages 4 La parole en démocratie 5 Liberté et égalité 6 Aristophane et la démocratie CHAPITRE 3 - L’Assemblée des femmes 1 Résumé de la pièce 2 La condition des femmes à Athènes 3 Les femmes au pouvoir ou « le monde à l’envers » Conclusion PARTIE 2 - Tocqueville, De la démocratie en Amérique CHAPITRE 1 - Le contexte de l’œuvre 1 La vie de Tocqueville 2 L’Ancien Régime et la Révolution CHAPITRE 2 - Analyse de l’œuvre 1 De la démocratie en Amérique 2 La thèse de la Démocratie en Amérique 3 L’analyse du despotisme démocratique dans le chapitre final 4 La méthode : la notion d’état social 5 La démocratie : tyrannie de la majorité 6 Révolution et esprit de révolution 7 De l’aristocratie à la démocratie : le sentiment de l’égalité 8 Bilan des paradoxes anthropologiques et politiques 9 La religion 10 Histoire providentielle ? 11 Échos tocquevilliens contemporains CHAPITRE 3 - Notices PARTIE 3 - Roth, Le complot contre l’Amérique CHAPITRE 1 - Vie et œuvre de Philip Roth 1 Biographie et carrière littéraire 2 L’œuvre littéraire CHAPITRE 2 - Analyse de l’œuvre 1 Introduction et présentation générale de l’œuvre 2 L’histoire au prisme de la fiction 3 Une vision critique de la démocratie américaine 4 Guerre et démocratie 5 Lindbergh président 6 Le spectre de la Shoah Conclusion PARTIE 4 - Comparaison des trois œuvres 1 La démocratie à l’épreuve de la guerre 2 La finalité de l’État 3 Campagnes électorales 4 Discrimination et clivage attentatoires aux principes démocratiques américains 5 La démocratie comme système institutionnel 6 Le salut public 7 Nationalité et citoyenneté américaines 8 La liberté de parole et d’opinion 9 La démocratie, ses orateurs et la dérive démagogique 10 La démocratie, la liberté et l’égalité 11 Un despotisme inédit 12 La tyrannie de la majorité 13 Démocratie directe, démocratie représentative 14 Une minorité menacée face à un despotisme inédit 15 Démocratie et éducation 16 Identité et humanité Conclusion PARTIE 5 - Préparer les concours CHAPITRE 1 - Méthodologie de l’écrit 1 Présentation générale 2 Le résumé 3 La dissertation Conclusion CHAPITRE 2 - Méthodologie de l’oral 1 Présentation de l’épreuve 2 Exemple du déroulement et des modalités d’une épreuve orale PARTIE 6 - Résumés et sujet de dissertation Résumé 1 - Montesquieu,L’Esprit des lois,« Du principe de la démocratie » Résumé 2 - La Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique Dissertation Introduction De l’antiquité à la modernité En définissant la démocratie comme « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » , Abraham Lincoln (président des États-Unis d’Amérique de 1860 à 1865) se faisait l’écho d’une tradition venue de la Grèce antique qui, d’ailleurs, nous a légué le mot. Démocratia accole en effet le nom dèmos (peuple) et le verbe krateïn (commander, gouverner). En définissant l’homme comme « animal politique » et « animal doué de raison », Aristote soulignait que, au-delà de la naturalité pure de la vie animale que régit l’instinct sans nécessiter d’autre médiation, les hommes ont besoin de principes régulateurs afin d’ordonner leur existence collective. Toutefois, dans les sociétés où vivent les hommes, il faut certaines conditions pour qu’émerge l’existence politique. Ce n’est que dans la Cité (polis en grec) qu’est né l’art proprement politique, lequel peut se décliner selon divers régimes. Le terme apparaît pour la première fois au V siècle avant J.-C. pour désigner une forme particulière d’organisation de la Cité, postérieure aux régimes royaux et aristocratiques, tous au demeurant très conscients de la nécessité d’assurer et de maintenir l’ordre par la médiation de la législation. « Le peuple doit combattre pour ses lois comme pour ses murailles » disait, au VI siècle avant J.-C., Héraclite d’Éphèse, pourtant peu porté à la démocratie… 1 e e La longue absence de la démocratie s’explique, dans l’Antiquité tardive, par la montée des empires (Alexandre le Grand, Rome, Byzance) puis, au Moyen Âge, par l’installation du système féodal fondé sur l’inégalité sociale des hommes définis, individuellement, par leur appartenance à l’un des ordres de la hiérarchie sociale. La démocratie a ainsi connu une longue éclipse de plus de deux mille ans, jusqu’à la deuxième moitié du XVIII siècle. Certes, la philosophie médiévale a continué à procéder à l’examen comparatif des différents régimes, sans toutefois sortir de l’ordre théorique comme c’est le cas chez Thomas d’Aquin (1225-1274) ou chez Marsile de Padoue (1275- 1342) dans son Defensor pacis (Défenseur de la paix). Dans la période classique, les arguments semblent repris d’Aristote et la question tranchée en faveur soit de la monarchie, soit de l’aristocratie élective ou gouvernement tempéré, soit d’un régime mixte. Spinoza fait figure d’exception. Il considère en effet que la démocratie est le régime « le moins éloigné de la liberté que la nature reconnaît à chacun », même s’il nuance son propos en en soulignant l’instabilité. Ce n’est en effet vraiment qu’au XVIII siècle, aux États- Unis d’Amérique tout d’abord, puis sous la Révolution française qui ne put cependant mener à bien sa tâche, que l’idée de démocratie acquit une précision qui lui permit de se distinguer d’une simple idée philosophique, et de devenir un facteur technique de l’organisation du gouvernement. Les questions fondamentales liées à la démocratie seront désormais : – Qui gouverne ? – Dans quelles limites et quel domaine ? Cette question est liée au caractère limité ou illimité du gouvernement et à l’extension du champ des règles démocratiques. – Au nom de quelles finalités ? Cette interrogation fait référence à la tension entre l’individu et la communauté ou, plus généralement, entre la liberté (les droits individuels) et l’égalité (la justice sociale). – Par des moyens directs ou indirects ? Gouvernement populaire direct ou institutions représentatives ? e e 2 – Sous quelles conditions et quelles contraintes ? Question relative au problème des conditions préalables socio- économiques et culturelles de la démocratie. Critères de la démocratie et extension de son concept Si l’on estime que la démocratie ne s’est réellement imposée qu’avec le suffrage universel, c’est plutôt à partir de la deuxième moitié du XIX siècle que l’on peut parler de nouveau de régime démocratique dans les pays occidentaux. En effet, pour que l’on puisse parler de démocratie, il faut qu’un régime réponde à un certain nombre de critères : la notion de débat contradictoire et la notion d’espace public, l’un étant le support ou le cadre indispensable de l’autre, la tenue d’élections régulières, la détention de la souveraineté par le peuple, l’autorité des lois, la délégation du pouvoir législatif en régime représentatif, le contrôle de l’exécutif par le législatif, la responsabilité de ceux qui exercent le pouvoir exécutif, la reddition de comptes. Mais l’usage et la signification du terme ont connu depuis le XIX siècle une extension considérable, le nombre d’États qui se proclament démocratiques ayant significativement augmenté. Cette extension s’accompagne toutefois d’un changement de statut. La démocratie ne désigne plus seulement un régime parmi d’autres, mais semble être l’aune de tout ordre politique légitime. Ayant accédé au statut d’idéalité normative, le concept de démocratie ne recouvre plus exclusivement désormais des institutions spécifiques, mais un ensemble de valeurs dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen constitue la charte et la référence. Alors qu’elle qualifiait un type fonctionnel de gouvernement, la notion tend, – et la variété de ses usages en témoigne –, à n’être plus strictement politique, alors même qu’elle est devenue la référence commune, non dénuée d’ailleurs d’équivoque, des projets politiques les plus divers. La démocratie apparaît ainsi comme un style de vie collective dont le mécanisme n’est pas toujours exprimé en idées claires et distinctes tant elle est le résultat de facteurs dont l’analyse doit mobiliser des 3 e e disciplines nombreuses. Il faut à l’observateur, écrit Georges Burdeau, « être tour à tour historien pour comprendre comment s’est forgée l’idée démocratique, sociologue pour en étudier l’enracinement dans le groupe social, économiste pour rendre compte des facteurs matériels qui agissent sur son évolution, psychologue pour saisir, dans les représentations que s’en font les individus, la source de l’énergie dont elle se nourrit, théoricien politique pour analyser uploads/Politique/ la-democratie-aristophane-tocqueville-roth-prepas-scientifiques-francais-philosophie-etienne-akamatsu-z-lib-org.pdf
Documents similaires

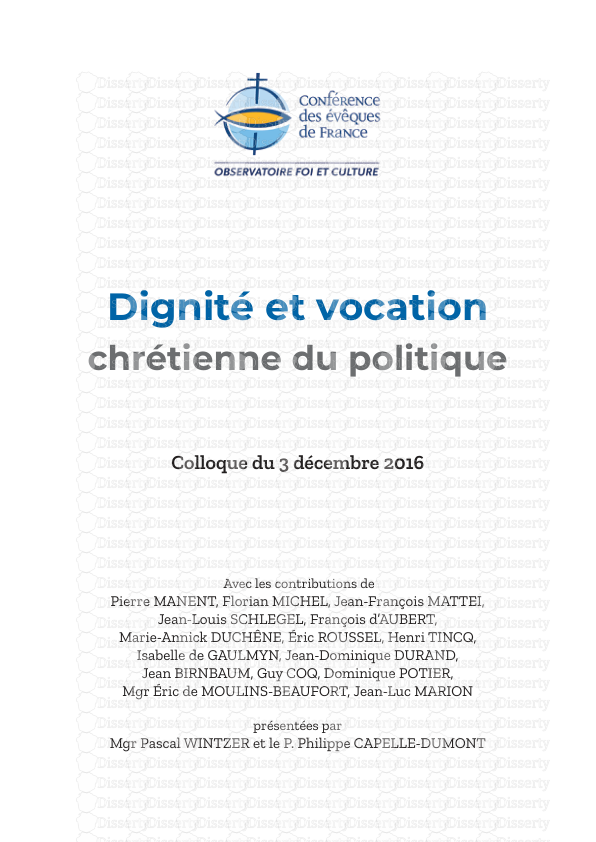








-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 17, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 3.1540MB


