Angioplastie transluminale des artères coronaires M Angioï N Danchin Résumé. –
Angioplastie transluminale des artères coronaires M Angioï N Danchin Résumé. – L’angioplastie transluminale coronaire percutanée est devenue une technique de revascularisation myocardique de référence. Les améliorations successives dont elle a fait l’objet ces dernières années font qu’elle peut dorénavant être envisagée chez la plupart des patients, dans des situations cliniques variées (angor stable, angor instable, ischémie silencieuse, infarctus aigu, postinfarctus) et pour une grande majorité des lésions coronaires. L’angioplastie coronaire est donc parallèlement devenue très sûre, avec en particulier un taux de complications hospitalières majeures faible grâce à la fois aux progrès réalisés sur le matériel (en particulier sur les stents) et à l’émergence de nouvelles thérapeutiques antithrombotiques. Elle est la technique de choix pour la revascularisation des atteintes monotronculaires. Pour les atteintes multitronculaires, de nombreuses études comparatives avec la chirurgie ont permis de montrer que les résultats en termes de survie et de survenue d’infarctus étaient similaires pour les deux techniques chez les patients non diabétiques. Néanmoins, le problème de la resténose reste le talon d’Achille de la technique en étant la source principale de réintervention chez les patients dilatés. À ce sujet, des progrès très importants ont été obtenus dans certaines indications grâce à l’utilisation des endoprothèses coronaires qui ont permis de diminuer significativement les taux de resténose. Enfin, l’angioplastie s’est avérée être une thérapeutique de reperfusion à la phase aiguë de l’infarctus très efficace entre les mains d’équipes entraînées. © 2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés. Introduction L’angioplastie transluminale coronaire (ATC) percutanée est une technique de revascularisation myocardique qui a été décrite initialement par Andreas Gruentzig et qui est utilisée chez l’homme depuis 1977. Elle est devenue, au fil des années, une méthode de revascularisation myocardique de référence, au même titre que la chirurgie coronaire. Durant ces dernières années, de nombreux progrès techniques ont rendu l’ATC plus sûre et ont donné la possibilité de traiter la majorité des lésions coronaires. Enfin, elle a acquis, grâce aux études comparatives randomisées angioplastie- chirurgie, un niveau de preuve suffisant de son efficacité. De ce fait, et compte tenu de sa facilité de mise en œuvre, l’activité d’angioplastie est actuellement en constante augmentation. En 1995, 278 982 angioplasties coronaires ont été réalisées en Europe (dont 53 724 en France), alors que seulement 184 330 interventions de revascularisation par pontages étaient réalisées [64]. Angioplastie coronaire : différentes techniques et mécanismes d’action MODE D’ACTION IMMÉDIAT L’objectif technique de l’ATC est le rétablissement d’un diamètre endoluminal le plus satisfaisant possible au niveau d’un segment Michaël Angioï : Praticien hospitalier. Nicolas Danchin : Professeur des Universités, praticien hospitalier. Service de cardiologie, hôpitaux de Brabois, centre hospitalier de Nancy, allée du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy, France. artériel significativement rétréci. Le traitement s’effectue donc in situ et c’est ce qui différencie la chirurgie coronaire par pontage de l’angioplastie. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour y parvenir, avec des modes d’action qui sont différents au niveau de la plaque et de la paroi artérielle adjacente. La technique de base est la dilatation au ballon qui a pour effet d’élargir la lumière artérielle grâce à plusieurs mécanismes. D’autres techniques sont disponibles : l’athérectomie (directionnelle ou rotative) et le laser, qui peuvent être utilisées seules ou qui, plus généralement, précèdent l’angioplastie au ballonnet. Enfin, les endoprothèses coronaires sont utilisées après la dilatation au ballon, soit pour traiter certaines des complications liées aux lésions induites par le ballon, soit pour en améliorer les résultats, ce qui est le cas le plus fréquent. ¶ Angioplastie au ballonnet L’action du ballon de dilatation au niveau des lésions d’athérosclérose a pu être étudiée chez l’homme, d’abord par des études anatomopathologiques et, plus récemment, par l’échographie endocoronaire. En pratique, le ballon qui est amené au niveau de la lésion (cf infra) est gonflé progressivement pour la dilater. C’est donc par l’application d’une contrainte de pression sur toute la circonférence de l’artère que la dilatation s’effectue. Le ballon agit à la fois sur la lésion athéromateuse et sur les parois saines adjacentes. L’élargissement de la lumière artérielle est consécutif à plusieurs mécanismes qui peuvent chacun être prédominants en fonction de la nature de la lésion dilatée. Schématiquement, le ballon induit un étirement et/ou une rupture de la plaque qui s’accompagne(nt) presque obligatoirement d’une dissection sous-intimale plus ou moins profonde et plus ou moins étendue. L’importance, en profondeur et de façon transversale, de cette dissection conditionne généralement la survenue de complications au décours de l’angioplastie. Les phénomènes de compression-redistribution de la plaque jouent un rôle beaucoup plus modeste que ce qui avait été décrit initialement. L’étirement des zones saines, contiguës à la Encyclopédie Médico-Chirurgicale 11-030-T-10 11-030-T-10 Toute référence à cet article doit porter la mention : Angioï M et Danchin N. Angioplastie transluminale des artères coronaires. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Cardiologie, 11-030-T-10, 2000, 12 p. lésion ou controlatérales en cas de sténose excentrique, contribue également à l’élargissement de la lumière. Le résultat final au site dilaté est donc un mélange de ces différentes actions (compression, rupture, fracture, dissection, étirement des parois saines adjacentes) et dépend en fait à la fois de la force appliquée et de la nature des lésions traitées (morphologie et consistance). Par exemple, pour une lésion concentrique, le mécanisme prédominant est la rupture/dissection. En revanche, pour une lésion très excentrique et dure, l’élargissement de la lumière est souvent lié à l’étirement de la paroi saine controlatérale, qui est en fait la zone de moindre résistance. Le coup de ballon entraîne également un effet abrasif en superficie et il s’ensuit une désendothélialisation de la paroi artérielle. Les lipides de la plaque d’athérome qui a été rompue se trouvent donc en contact avec le sang et induisent, en conjonction avec d’autres stimuli, une activation des systèmes d’hémostase. Il en résulte donc une situation à risque thrombogène qui doit être contrôlée par un traitement antithrombotique adéquat. ¶ Endoprothèses coronaires Les endoprothèses coronaires ont un effet mécanique sur la paroi. Elles constituent un véritable système d’étayage qui maintient la paroi artérielle en place grâce à leur support. Elles permettent de prévenir ou de traiter un retour élastique de la paroi et constituent le traitement de choix des dissections coronaires en les « recollant » contre la paroi. Nous verrons ultérieurement qu’il s’agit de la méthode qui permet généralement d’obtenir les meilleurs résultats initiaux en termes d’élargissement de la lumière artérielle. Par cet effet de restauration d’un calibre artériel optimal, elles permettent également de combattre un des facteurs favorisant la thrombose que constitue le ralentissement circulatoire lié à une obstruction persistante, même partielle. ¶ Autres techniques Ces techniques ont un objectif commun qui est différent du ballon : c’est l’ablation de la plaque (debulking). Elles peuvent constituer à elles seules le geste d’angioplastie, mais comme dans la plupart des cas l’élargissement de la lumière artérielle obtenu est insuffisant, une dilatation complémentaire est habituellement nécessaire. Athérectomie rotative à haute vitesse (Rotablatory) L’ablation de la plaque est, dans ce cas, assurée par une fraise métallique recouverte de copeaux de diamant qui tourne à haute vitesse (jusqu’à 200 000 tours/min). L’effet de la fraise s’exerce uniquement au niveau des segments artériels pathologiques grâce à la différence de consistance et de topologie avec la paroi saine. Ainsi, théoriquement, la fraise se contente de repousser la paroi saine élastique et abrase les segments pathologiques, pulvérisant la plaque en particules d’environ 5 mm en laissant une surface abrasée lisse et régulière. Ces microparticules sont projetées dans le lit d’aval et drainées par la microcirculation. La quantité embolisée est fonction de l’importance de la lésion et du nombre de passages de la fraise. Plusieurs conséquences sont possibles : des phénomènes de flux lent avec élévation enzymatique liée à l’embolisation de ces débris qui sont alors responsables de multiples foyers de micro-infarcissements et de phénomènes de spasme coronaire. L’utilisation de ce système est généralement réservée aux lésions calcifiées et aux cas où il est impossible de lever une lésion au ballon. Athérectomie directionnelle Il s’agit d’une technique peu employée en Europe, mais plus utilisée en Amérique du Nord. L’ablation de la lésion se fait par l’intermédiaire d’un athérotome coupant dans un plan de l’espace avec un système de guillotine. Les problèmes posés par ce type d’intervention sont liés à son encombrement, au positionnement optimal par rapport à la lésion à traiter et au contrôle de la profondeur de l’ablation. Son utilisation préférentielle est représentée par les lésions focales, courtes, proximales et excentriques. L’émergence de l’échographie endocoronaire comme système de contrôle du positionnement de l’athérotome et de la qualité de l’ablation, ne semble cependant pas devoir élargir les indications de l’athérectomie directionnelle qui sont actuellement limitées. Laser De nombreuses technologies sont développées dans ce domaine, mais la technique qui est employée actuellement est celle du laser Excimer. Le rayonnement induit par le laser agit sur les tissus en les transformant en un mélange de gaz et de petites particules créé par la rupture des ponts moléculaires. Il en résulte une véritable vaporisation de la plaque d’athérome avec un effet thermique modéré. Outre l’infrastructure et le coût uploads/Sante/angioplastie-transluminale-des-arteres-coronaires.pdf
Documents similaires








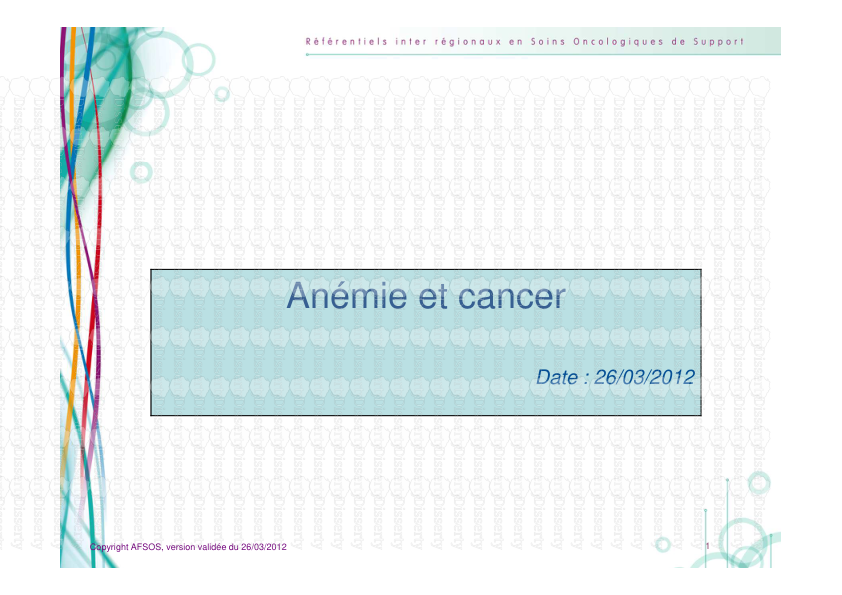

-
99
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 11, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.6521MB


