INTRODUCTION GENERALE A L’ETUDE DU DROIT PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF. D
INTRODUCTION GENERALE A L’ETUDE DU DROIT PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF. Dans le langage juridique, comme dans le langage courant, existent des mots susceptibles d’être perçus dans plusieurs sens. Il en est ainsi, par exemple, du mot « Droit ». Le mot droit est classiquement entendu dans deux sens distincts. Dans un premier sens, le mot est perçus comme l’ensemble des normes ou règles juridiques destinées à réguler les relations pouvant exister entre les personnes. Dans cette première acception, le droit est analysé sous l’angle de sa finalité, de son objet. D’où, l’expression de « Droit objectif ». Exemples : - La règle selon laquelle, le débiteur paie sa dette sur l’ensemble de ses biens présents et à venir : art. 200 COCC. - L’auteur d’un dommage causé à autrui est tenu de verser des dommages- intérêts à la victime. Dans un second sens, le mot droit désigne l’ensemble des droits, pouvoirs ou prérogatives reconnus aux sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes. Ici, le droit est perçu sous l’angle de son titulaire, le sujet de droit. D’où l’expression, « Droits subjectifs ». Exemples : - Le droit de propriété ; - Le droit de créance ou - Le droit d’auteur. Ces deux sens du même mot droit seront analysés successivement, en commençant par le premier sens, le droit objectif. 1 PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF OU REGLE DE DROIT. Le droit objectif, également appelé règle de droit, désigne, comme indiqué précédemment, l’ensemble des règles ayant pour finalité la réglementation des relations sociales. Son étude peut, pour l’essentiel, être articulée autour de trois points : - La notion de droit objectif ou règle de droit ; - Les branches du droit objectif et, - Les sources du droit objectif. CHAPITRE I : LA NOTION DE DROIT OBJECTIF. La règle de droit n’est pas la seule norme ayant pour destinataire la personne. Celle-ci obéît également à d’autres normes. Il s’agit, notamment, de la règle morale et de la règle religieuse. Dès lors se pose la question de l’identification de la règle de droit par rapport à ces dernières, qui lui sont voisines. Cette question d’identification de la règle de droit peut être résolue, en passant par une analyse deux points essentiellement : les caractères et fondements philosophiques de la règle de droit. SECTION I : LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT. On reconnait, traditionnellement, à la règle de droit quatre caractères. Il s’agit, d’une part, des caractères général et obligatoire et, d’autre part, des caractères contraignant et permanent. 2 Paragraphe I : Caractère général et caractère obligatoire. A.Le caractère général. Ce premier caractère, également appelé caractère abstrait ou encore caractère impersonnel, signifie que la règle de droit est en principe applicable à tous, c’est-à-dire aussi bien aux gouvernants qu’au gouvernés. Toutefois, ce caractère général doit être nuancé, relativisé, pour tenir compte de certaines règles de droit qui ne s’appliquent pas à toutes les personnes, mais seulement à certaines catégories de personnes déterminées. Exemples : - Les règles qui forment le droit commercial ; - Les règles qui constituent le droit du travail …etc. B.Le caractère obligatoire. Ce second caractère veut dire que les personnes auxquelles s’adresse une règle de droit ont l’obligation de respecter les prescriptions de celle-ci. Mais, comme pour le caractère général, ici aussi des nuances s’imposent. En effet, si toutes les règles de droit sont obligatoires, elles n’ont cependant pas toutes la même force obligatoire ; d’où la distinction traditionnelle entre les règles impératives et les règles supplétives. Les règles impératives, ce sont celles dont la force obligatoire est absolue ; elles s’imposent à leurs destinataires. Ces derniers en effet, ne peuvent par leur volonté contraire se soustraire à l’application de telles règles. Exemple : la règle de l’article 9 COCC relative à la charge de la preuve. S’agissant des règles dites supplétives, c’est la solution contraire qui prévaut. Ces règles ne possèdent pas une force obligatoire absolue ; elles ne s’imposent pas à leurs destinataires. Exemple : la règle de l’article 14 COCC concernant la preuve des actes juridiques. 3 Paragraphe II : Caractères contraignant et caractère permanent. A.Le caractère contraignant. Ce troisième caractère signifie que la règle de droit doit être respectée sous peine de sanction. C’est pourquoi on l’appelle aussi caractère coercitif. Les sanctions qui sont attachées aux différentes règles de droit sont variées. Il y a : - des sanctions civiles (annulation d’un contrat, paiement de dommages- intérêts…etc.) ; - des sanctions pénales (amende, emprisonnement, peine de mort…etc.) ; - des sanctions administratives ou disciplinaires (avertissement, blâme, radiation…etc.). B.Le caractère permanent. Ce dernier caractère veut dire qu’une règle de droit reste en vigueur, conserve sa force obligatoire tant qu’elle n’est pas abrogée, c’est-à-dire supprimée. Par conséquent, le juge peut imposer son respect aux sujets de droit, sous peine de sanction. SANCTION II : LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA REGLE DE DROIT. La question qui se pose ici est la suivante : comment, d’un point de vue philosophique, naissent les règles de droit ? Qui les crée ou les élabore ? A cette question, les philosophes ont répondu, mais d’une façon divergente. Cela a donné naissance à deux doctrines ou conceptions : la doctrine idéaliste et la doctrine positiviste. 4 Paragraphe I : La doctrine idéaliste. La doctrine idéaliste ou doctrine du droit naturel enseigne que les règles du droit proviendraient de la volonté de Dieu ou de celle de ses prophètes. Par conséquent, l’homme, la personne ne serait pas à l’origine des règles de droit. Cette doctrine, qui est apparue la première trouve des applications dans les pays islamistes, c’est-à-dire les pays qui se fondent sur la charia Paragraphe II : La doctrine positiviste. D’après cette seconde doctrine, les règles de droit trouveraient leur origine dans la volonté de l’homme, la personne, et non dans la volonté de Dieu ou de celle de ses prophètes. Mais dans la doctrine positiviste, il y a deux écoles qui s’opposent : l’école du positivisme étatique et l’école du positivisme sociologique. L’école du positivisme étatique enseigne que c’est l’Etat qui crée les règles de droit, à travers certaines de ces institutions (parlement, gouvernement…). Dans cette école, les sources de la règle de droit sont représentées par : la loi, le règlement…etc. Ce qui n’est pas le cas dans l’école du positivisme sociologique. Pour les auteurs du positivisme sociologique, les règles de droit trouveraient leur origine ou source, non dans la volonté de l’Etat, mais plutôt dans les comportements ou attitudes des citoyens. Dans cette seconde école, les sources de la règle de droit sont représentées par les coutumes ou usages. Mais après analyse, l’on observe que c’est la doctrine positiviste qui l’emporte sur la doctrine idéaliste ; et que c’est l’école du positivisme étatique qui prend le dessus sur l’école du positivisme sociologique. C’est qu’en effet, d’une part, il y a plus de pays non islamistes que de pays islamistes. Et, d’autre part, la majeure partie des règles de droit provient de la volonté de l’Etat et non des comportements des citoyens. Pour terminer, notons que la règle de droit se distingue des autres règles de comportement social, notamment de la règle morale et de la règle religieuse. 5 Elle se distingue de ces dernières à plusieurs égards : du point de vue de sa source, de son but et de son domaine. Mais fondamentalement la distinction se situe au niveau du caractère général de la règle de droit et de la nature de sa sanction. En effet, la portée de la généralité de la règle de droit ne se retrouve dans aucune autre norme de conduite sociale. Quant à sa sanction, elle est étatique. Ce qui n’est pas le cas de la sanction des autres règles de comportement social. CHAPITRE II : LES BRANCHES DU DROIT OBJECTIF. Les règles qui forment le droit objectif sont diverses. Pour cette raison, on les range traditionnellement dans des catégories juridiques appelées « branches du droit objectif ». Ces branches sont au nombre de trois. La branche du droit privé et la branche du droit public, qui sont les principales branches. Entre elles, se situe une troisième branche, la branche du droit à caractère mixte. SECTION I : LES PRINCIPALES BRANCHES : LE DROIT PRIVE ET LE DROIT PUBLIC. Ces deux branches sont ainsi qualifiées en ce sens qu’elles se partagent la grande partie des règles formant le droit objectif. Paragraphe I : La branche du droit privé. Le droit privé est généralement défini comme l’ensemble des règles juridiques applicables aux personnes privées, également appelées les particuliers. Ce sont les personnes dont l’intervention, l’activité est motivée par la recherche et la satisfaction d’un intérêt personnel, particulier. Exemple : Commerçants, agriculteurs…etc. Le droit privé est un droit égalitaire. Les personnes auxquelles il s’applique ne sont pas dans une situation hiérarchique. Suivant son espace d’application, le droit privé se subdivise en deux sous branches : le droit privé national et le droit international privé. 6 Le droit privé national ou droit privé interne est celui dont le champ d’application est le uploads/S4/introduction-generale-a-l-x27-etude-du-droit.pdf
Documents similaires





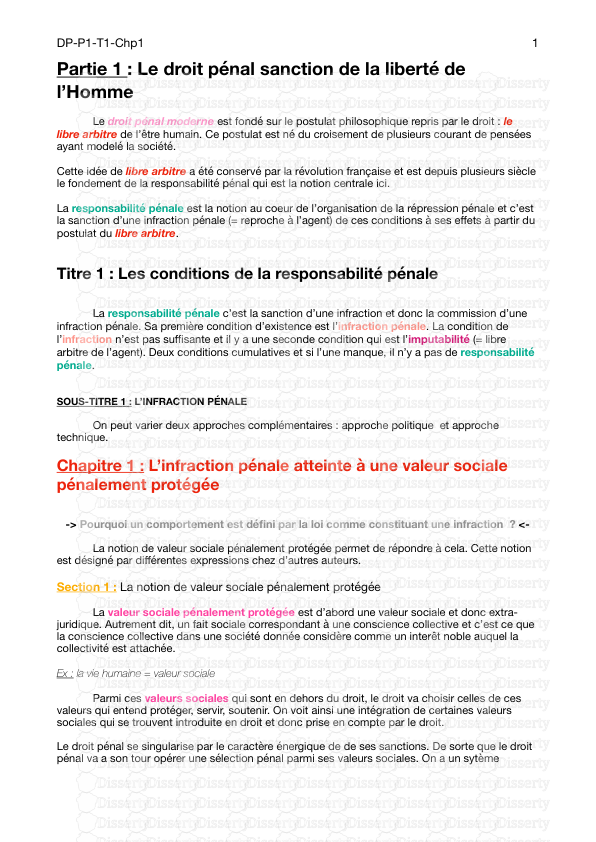




-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2044MB


