Jacques Benveniste en collaboration avec François Cote Ma vérité sur la « mémoi
Jacques Benveniste en collaboration avec François Cote Ma vérité sur la « mémoire de l’eau » Préface du professeur Brian D. Josephson Albin Michel Table Avant-propos...............................................................................................................4 Préface, par le professeur Brian D. Josephson.................................................................5 Introduction .............................................................................................................7 1. Itinéraire d’un chercheur gâté.......................................................................10 2. Être ou ne pas être... publié dans Nature........................................................25 3. La contre-enquête ...........................................................................................38 4. Les rats quittent le navire................................................................................44 5. Censure scientifique........................................................................................54 6. Le champ des molécules.................................................................................65 7. Le sérum contaminé .......................................................................................75 8. La tête sur le billot...........................................................................................83 9. La biologie numérique....................................................................................95 10. Scientistes, intégristes, rigolades et diffamation ........................................104 Conclusion............................................................................................................116 Postface, par Jérôme, Laurent et Vincent Benveniste...................................................120 Avant-propos Jacques Benveniste a terminé sa route le 3 octobre 2004. À la fin des années 90, notre père avait entrepris la rédaction de cet ouvrage ; il conservait ce ma- nuscrit à portée de main, l’alimentant régulièrement de ses réflexions et correc- tions. Il aurait souhaité le faire paraître à une date symbolique, par exemple au lendemain d’une « monumentale » publication scientifique (pourquoi pas dans Nature ?) qui aurait marqué la reconnaissance et l’acceptation définitive de ses découvertes. Le destin en a décidé autrement ; nous avons résolu de porter ce texte à la connaissance du public. Jérôme, Laurent et Vincent Benveniste 5 Préface par le professeur Brian D. Josephson1 J’ai rencontré Jacques Benveniste pour la première fois lors d’un colloque aux Bermudes, quelques mois avant la parution de son article très controversé, publié par Nature en 1988. À l’époque, j’étais loin d’imaginer la tournure que prendraient les événements. Par la suite, nous sommes restés en contact et Jac- ques m’a tenu informé de la progression de ses recherches. En mars 1999, à mon invitation, il est venu donner une conférence à Cambridge dans le cadre du colloque général du département de physique. Nous l’avions convié à dé- crire ses travaux, conscients de leur intérêt scientifique et des conséquences po- tentiellement considérables induites par leurs résultats. Ces derniers ne man- quaient pas de surprendre, mais le laboratoire Cavendish de Cambridge a été le cadre de nombreuses découvertes étonnantes durant les cent vingt-cinq derniè- res années. Malgré la controverse entourant ces travaux, nous avons décidé de ne pas suivre le troupeau et de ne pas ignorer ou censurer de telles recherches. Lors de son intervention, le docteur Benveniste a décrit des expériences au cours desquelles un signal biologique est enregistré sur le disque dur d’un or- dinateur, transmis par internet en un autre lieu d’expérimentation où les effets spécifiques de la molécule source sont alors restitués sur un système biologique. Benveniste avait apporté du matériel d’expérience et il a reproduit devant nous ses plus récentes expériences. Celles-ci se sont avérées aussi probantes que pos- sible, compte tenu du temps limité dont nous disposions. Notre laboratoire a filmé la conférence et je projetais de publier cet enregis- trement un jour prochain, lorsque Jacques Benveniste aurait reçu le prix Nobel « pour l’élucidation des mécanismes biologiques relatifs à la structure de l’eau ». Mais cette distinction est décernée aux scientifiques seulement de leur 1 Le professeur Brian Josephson est lauréat du prix Nobel de physique 1973 pour ses travaux sur les supra- conducteurs couplés, appelé aussi « effet Josephson ». Il fait partie du prestigieux laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge. 6 vivant. C’est bien dommage. Je suis persuadé que la contribution scientifique du docteur Benveniste sera un jour reconnue à sa juste valeur. Que nous dit la science sur la possibilité de l’existence de la « mémoire de l’eau » ? Les scientifiques qui ne sont pas érudits en matière d’eau tendent à en avoir une vision naïve : un liquide composé de molécules H20 plus ou moins iso- lées, en mouvement. En fait, l’eau est bien plus complexe, avec des molécules individuelles s’agglutinant temporairement pour former un réseau. Que ces molécules puissent interagir de façon à produire un mécanisme permettant la mémoire de l’eau n’aurait rien d’inconcevable. Les scientifiques bien informés au sujet de l’eau prennent beaucoup plus au sérieux la proposition de mémoire que ceux qui ne le sont pas. En biologie également, les scientifiques bien in- formés admettent l’importance de la structure de l’eau. Enfin, je voudrais souligner les qualités personnelles de Jacques Benveniste, sa détermination à continuer ses recherches malgré tous les obstacles, et sans jamais se départir de son sens de l’humour. Ceux qui affectent de croire que Benveniste était condamné au déclin dès lors qu’il s’aventurait en dehors des domaines conventionnels où il avait recueilli tant d’approbation et de succès, se trompent totalement. Professeur Brian D. Josephson 7 Introduction 28 juin 1988 : la revue britannique Nature, la plus influente des revues scienti- fiques généralistes au monde (avec sa concurrente américaine Science), publie un article intitulé : « Dégranulation des basophiles humains par de très hautes dilutions d’un anti-sérum anti-IgE. » Le titre est parfaitement obscur pour le grand public, pourtant la rédaction en chef de Nature a pris soin de diffuser ce texte aux grands médias de la planète, comme chaque fois qu’un article impor- tant est publié dans la revue. Dans tous les pays, la presse donne un formidable écho à cet article et traduit en termes courants le contenu de l’article : l’eau pourrait conserver un souvenir, une empreinte, de substances qui y ont transité. Cela représente une véritable révolution scientifique, à la tête de laquelle me voici bombardé. Quelques semaines plus tard, à la suite d’une « contre- enquête » menée dans mon laboratoire par une équipe de Nature dans des conditions particulièrement choquantes, la revue décide que les résultats de mes expériences n’ont aucune réalité. Commence alors pour moi un processus de marginalisation qui me conduit de la direction d’une unité de recherches de l’Inserm1 comptant plusieurs dizaines de personnes à celle d’un laboratoire in- dépendant pour lequel je dois trouver moi-même les crédits de fonctionne- ment. Ce laboratoire est une ancienne annexe en préfabriqué située sur le par- king de l’unité que je dirigeais. 21, 22 et 23 janvier 1997 : le quotidien Le Monde revient sur cette affaire. Trois jours de suite et sur six pleines pages, le journaliste Éric Fottorino retrace ce « roman-feuilleton chez les scientifiques ». L’enquête, fouillée et honnête, est remarquable. Mais sa lecture provoque chez moi un condensé des impressions et des émotions, bonnes et, plus souvent, mauvaises, que j’ai ressenties au long de ces huit dernières années. Ce ne sont pas les écrits d’Éric Fottorino qui in- duisent ce malaise, mais les inepties proférées par bon nombre des « scientifi- ques » qu’il a interviewés pour les besoins de son enquête et dont il a retranscrit les propos. De soi-disant scientifiques et de pseudo-chercheurs donnent grave- ment leur avis sur mes travaux relatifs aux hautes dilutions (la mémoire de 1 Institut national de la santé et de la recherche médicale. 8 l’eau) sans avoir assisté à mes expériences, ou même sans en avoir lu attentive- ment les résultats ; certains vont jusqu’à m’accuser de fraude scientifique, sans en apporter le moindre commencement de preuve. J’ai donc estimé qu’il était temps pour moi de livrer dans le détail ma vérité sur le dossier de la mémoire de l’eau, de raconter les manœuvres, les coups bas, les lâchetés, les lâchages et les insultes dont j’ai été l’objet depuis dix ans. Je ne cherche nullement à passer pour une victime ou à régler mes comptes. J’ai vécu quinze ans d’une aventure passionnante ; si je ne souffrais pas du mal de mer, je pourrais la comparer à un tour du monde en solitaire, pour l’excitation perma- nente et les frayeurs occasionnelles. Car — il faut dans cet exercice être assez lu- cide avec soi-même — j’aime la compétition dans la recherche, la bagarre scienti- fique, la baston intellectuelle, dans le respect des règles déontologiques. « Mort aux cons ! » m’écrit un scientifique de mes amis en quittant avec dé- goût une position très officielle (ce qui ne l’empêche pas de continuer à siéger, sans rire, à l’Académie des sciences). Je suis plutôt d’accord avec cette pétition de principe. Mais, pris et appliqué au pied de la lettre, ce mot d’ordre consti- tuerait un génocide scientifique. Une telle affirmation traduit-elle mon arro- gance, ma paranoïa ? L’arrêt de tout progrès en physique théorique depuis les années 30, le surplace, par-delà les exploits technologiques, de la science en gé- néral et de la biologie en particulier, suffiraient à donner un début de justifica- tion à ce massacre intellectuel programmé. Pourquoi cette léthargie ? J’esquisserai trois explications. 1) Le règne du Big Science/Big Business/Big Organization. La subordination, en dernier ressort, de la recherche à l’argent date du Pro- jet Manhattan (fabrication de la bombe A) qui a entraîné la mainmise du gou- vernement américain sur la recherche, l’injection de capitaux énormes et la création de gigantesques structures économico-scientifiques. Cette prédomi- nance du business peut expliquer l’accueil réservé aux travaux sur les hautes dilutions, susceptibles de bousculer les grands équilibres de l’industrie pharma- ceutique. La liberté de pensée est par ailleurs compromise par les grandes re- vues scientifiques qui outrepassent uploads/Science et Technologie/ jacques-benveniste-ma-v-rit-sur-la-m-moire-de-l-eau.pdf
Documents similaires


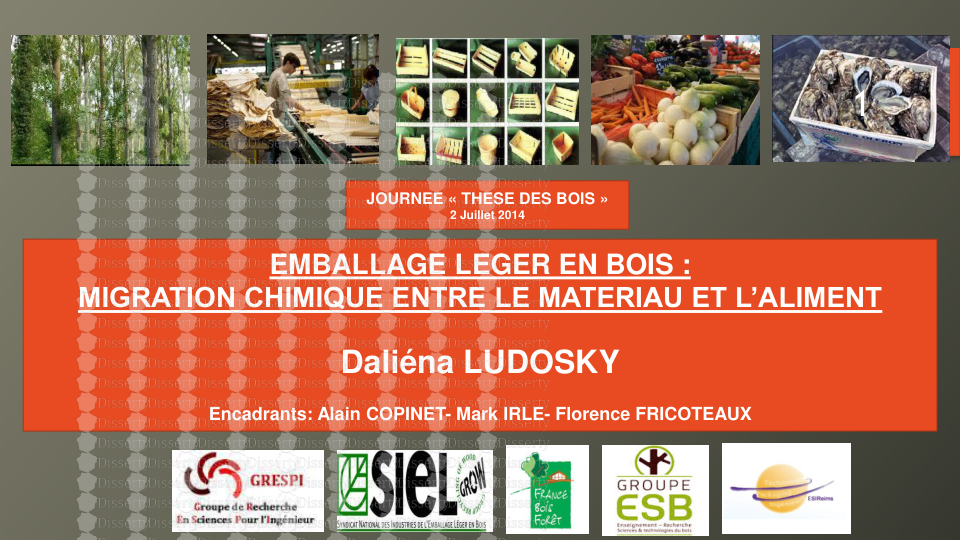







-
215
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 13, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6097MB


